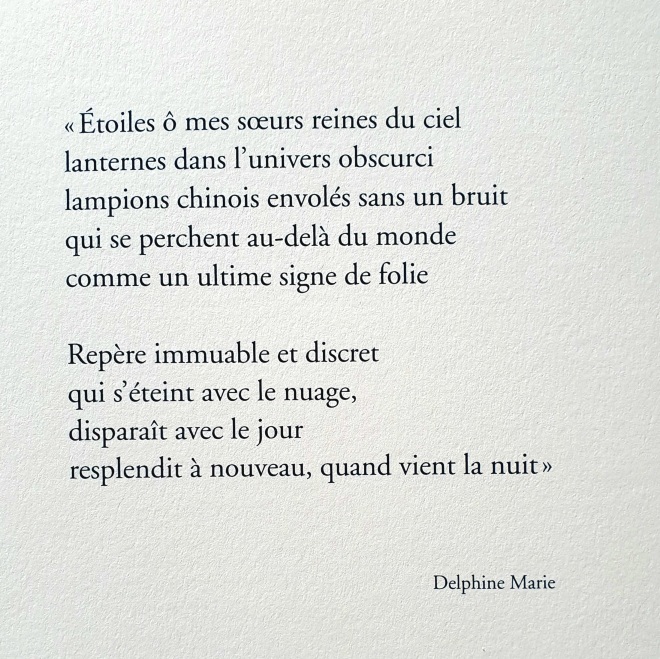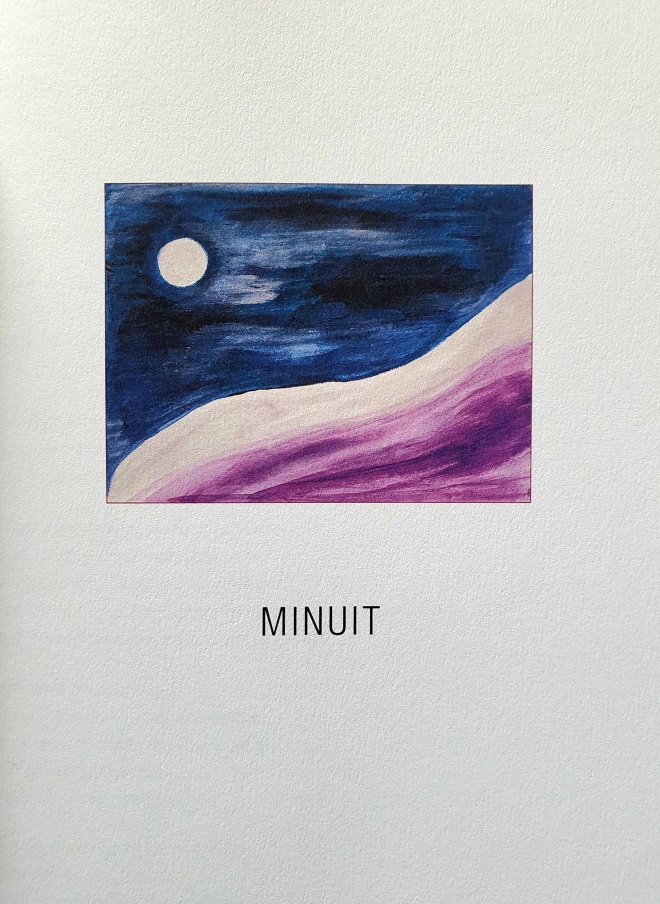Le rat des villes et le rat des champs
Nous voilà donc quasiment au terme de nos pérégrinations dans la Bourgogne magique et fabuleuse d’Henri Vincenot. Avec lui, nous aurons exploré les routes, chemins et villages de cette belle région chargée d’art et d’histoire, véritable cœur battant de la France ; monté des collines et longé des canaux ; suivi des signes, des symboles et des mystères ; remonté le temps à la rencontre des bâtisseurs de cathédrales ; tracé des zigzags à travers le Beaujolais, l’Auxois et le Dijonnais…
Nous aurons fait une plongée au cœur de l’univers bourguignon, dans l’histoire de la Gaule celte et romaine, admiré l’art des compagnons – villages médiévaux, édifices sacrés, clés de voûtes, vitraux et chapiteaux – et tenté de percer les mystères de la géométrie sacrée; nous nous serons interrogés sur la persistance de cet héritage, à l’ère des sciences rationalistes hyper-spécialisées… Nous aurons, ensemble, cherché des clés dans diverses lectures sur le lien encore ténu entre l’art du moyen-âge et la franc-maçonnerie moderne…
Nous aurons joyeusement erré entre abbayes et vignobles, retrouvé des lieux chers au cœur de Vincenot et dont il parle si admirablement, goûté à pleins poumons l’air de la Bourgogne et à pleine bouche ses spécialités, imaginé la vie d’antan au fil du canal, au plus profond d’une combe ou dans un château fort.
Voici qu’à son terme, notre périple semble dire : et quid des villes qui, à leur manière aussi chargées d’histoire, constituent le tissu urbain de la Bourgogne ? Et nous voilà, cahin-caha, nous dirigeant vers Dijon, dont on nous a vanté les beautés, tant anciennes que modernes. Nous avons passé la nuit à l’entrée de la réserve naturelle de la combe Lavaux, au-dessus de Gevrey-Chambertin (combe et bois qui seront malheureusement victime d’un incendie en août 2023) et pris un petit déjeuner savoureux au Tue-Chien dans la ruelle du centre de ce bourg viticole : un bon pain d’épices et confiture d’abricots maison. Nous sommes donc encore tout empreints de l’atmosphère des vignes et de la campagne… Et, pour être franche, ce milieu de journée en ville est décevant : peut-être trop comblés par les charmes de la Bourgogne des vallons et des collines, sommes-nous peu réceptifs à des considérations plus urbanistiques ?
Selon un itinéraire culturel qu’on nous a recommandé, nous suivons les chouettes, petits symboles en laiton sur les trottoirs : le parcours est long et fastidieux, nous emmène loin du centre et ne nous émerveille pas. Où sont les beaux hôtels particuliers, les maisons à colombages, chapelles, les abbayes, les celliers ? Nous en attrapons quelques-uns au vol mais ne nous sentons pas « pris en main » ni orientés par ce parcours. Pourtant, Dijon regorge de bâtiments historiques – que je découvrirai plus tard sur internet. Sans doute fait-il gris et sommes-nous un peu fatigués… Sans doute, c’est dimanche, et le seul quartier animé est celui, un peu glauque, de la gare… Un parfum de désolation, d’abandon règne. Les aménagements place de la Gare et place de la Libération sont à nos yeux des chefs d’œuvre d’architecture urbaine ratée et, loin de mettre en valeur les monuments historiques, semblent vouloir les occulter.
La crypte de la cathédrale est fermée pour rénovation… Le repas chez un italien-marocain, l’un des rares ouverts, près de la gare, est décevant, tout juste honnête. Bref cette incursion urbaine n’est pas sans me laisser un arrière-goût d’amertume… Seuls auront grâce à nos yeux, un magnifique ginkgo et un platane bicentenaire qui trônent dans le parc botanique… la nature, toujours splendide, jamais décevante ! (Et l’épicerie arabe du coin chez qui je trouve des piles de moutarde de tous choix et toutes couleurs, en pleine « pénurie »).
Heureusement, j’avais l’imagination pour me consoler et me transporter dans une autre époque. En sortant de la ville par la rue Monge, on entrevoit encore le Dijon d’antan. C’est un vieux quartier aux immeubles authentiques, avec des maisons à colombages, où j’ai le plaisir de tomber, par hasard, sur le fameux Hôtel du Sauvage situé rue Darcy, encore dans son jus, où Vincenot relate que descendait Jean Lépée : le conducteur de charrette qui venait le chercher au pensionnat et le ramener dans sa campagne, au terme d’un périple de plusieurs heures… Là, le passé fait un instant irruption, fugitif, éternel, tel un film aux couleurs délavées et aux images vacillantes; en lieu et place du calme quelque peu bourgeois de la grande cour d’auberge que j’aperçois de la rue, celle-ci s’égaye de mille cris et personnages et je crois revoir le « caravansérail » décrit par Vincenot d’il y a tout juste un siècle : attelages, chevaux et chariots, et toute l’activité bruyante et frémissante des messagers de l’Auxois chargeant et déchargeant leurs colis.
Replongeons-nous quelques instants dans la prose savoureuse de La Billebaude !
« Aux vacances j’avais deux façons de regagner mes friches et mes bois. D’abord le train : la ligne Paris-Lyon Marseille traversait nos monts par le plein travers, obligée qu’elle avait été de grimper comme elle avait pu dans les combes jusqu’à la haute ligne de partage des eaux entre Seine et Rhône. Là, elle passait sous la crête, par le fameux tunnel de Blaisy-Bas : je pouvais donc prendre l’omnibus et descendre, après le tunnel, à la gare de Blaisy-Bas (…). Quoi qu’il en fût, le train était trop coûteux pour nous. Pensez : deux francs cinquante de Dijon à Blaisy ! (…)
Heureusement, il y avait le Jean Lépée. J’allais à l’Hôtel du Sauvage, je trouvais Jean Lépée en train de trier et de charger ses colis au milieu du va-et-vient des autres messagers dans la cour de l’auberge. Souvent il emmenait des cuirs et des croupons pour mon grand-père et cela remplissait la carriole d’un bon parfum de tanin. Quand le chargement était fini, je me pelotonnais sur un siège qu’il m’installait entre les caisses de sucre et de chicorée, tout près de sa banquette, pour pouvoir jaser sous la bâche ronde. On partait par le boulevard de Sévigné, le pont de l’Arquebuse, le pont des Chartreux; après quoi, c’était la campagne. (…)
Jean Lépée était un des plus grands philosophes que j’aie jamais connus. (…) S’il pleuvait, ça faisait pousser ses salades. S’il faisait sec, ça faisait mûrir ses nèfles. La vie était merveilleuse autour de lui. (…)
Pendant que roulait le chariot je l’observais en pensant : « Voilà ce que c’est que cette réussite dont tout le monde parle, voilà un homme qui a réussi ! » et je le lui disais :
– Monsieur Jean, vous, on peut dire que vous avez réussi ! Il répondait :
– Boh! Oui ! Oui ! peut-être, p’t’être ben ! J’ai pas à me plaindre. C’est la vie!
– Je voudrais bien vous imiter.
– Boh! p’t’être, p’t’être ben, c’est pas difficile : y’a qu’à faire comme moi.
– Mais c’est que voilà, Jean, on m’envoie aux écoles pour être ingénieur.
– Ah ! t’es pas obligé d’être reçu à tes examens ! répondait-il en clignant de l’œil, un œil bourguignon gros comme une groseille au fond de son orbite.
– Ce ne serait pas bien de ma part, répondais-je alors, ma famille fait des sacrifices pour moi, ce serait mal les payer que de tricher exprès.
– Boh, p’t’être ben, p’t’être ben ! On cause comme ça pour causer, hein ! Mais on ne fait pas d’omelette sans casser les œufs ! Si tu es ingénieur un jour, c’est sûr tu ne pourras plus jamais être heureux comme moi, faut choisir ! Et puis, tu veux que je te dise, on ne pourra plus jamais être messager comme moi dans le temps qui vient, j’y vois gros comme La Cloche (La Cloche était le plus grand hôtel de Dijon. 250 chambres, je crois). Il hochait la tête et concluait :
– Le jour vient où tout sera bien emberlificoté. «
Paroles prophétiques ? Il me semble que nous y sommes….
Je ne puis m’empêcher d’explorer ce filon, puisque Vincenot avait une gouaille sans égale pour descendre le « progrès » et ses inventions parfois utiles et souvent machiavéliques, d’après cette philosophie de vie simple et respectueuse de son environnement qu’il se forge dès son adolescence.
Quelques pages auparavant dans La Billebaude, où il relate son internat au collège Saint-Joseph : il a la nostalgie de sa famille, de la campagne et des longues errances en zigzag dans les collines à la poursuite de quelque menu gibier.
Il reçoit des lettres de ses grands-parents lui relatant par le menu, telle chasse, tel épisode de la vie au village, et il se sent comme en exil. « Et ces lettres cachées dans des colis de victuailles (que lui livre le fameux Jean Lépée chaque semaine) me mettaient l’imagination en chaleur: j’étais un prisonnier, j’étais Vercingétorix dans Mamertine, j’étais le Masque de fer à la Bastille, j’étais Monte-Cristo au château d’If, et c’était merveilleux. »
Il est, à cet âge, déjà très conscient – ou est-ce avec le recul, lorsqu’il écrit ces lignes – du tournant de vie qu’il est en train de prendre, et de tout ce que cela comporte. Il pense avec regret à ses petits camarades restés à la campagne (et qui l’envient, eux, d’être dans une grande école pour y préparer un bel avenir!) :
« Mon bel avenir ! Mais je lui tournais le dos ! Mon avenir était dans les pâturages, dans les bois où les derniers de la classe jouaient à la tarbote en gardant les vaches, en attendant d’aller à la charrue ou d’apprendre à raboter les planches. Leur école avait le ciel pour plafond, et que me restait-il à moi, condamné aux études à perpète ? Une journée de liberté par semaine, celle de la grande promenade, pour reprendre respiration, comme une carpe de dix livres qui vient happer une goulée d’air à la surface d’un plat à barbe, oui, voilà l’impression que je me faisais.
Devant moi, je le pressentais sans bien l’imaginer avec précision, s’étendait une vie où je ne vivrais vraiment qu’un jour sur sept, comme tous les gens des villes et des usines, le jour de la grande promenade des bons petits citadins châtrés. »
Cette nostalgie des choses simples, comme je la comprends et comme elle a, aussi, guidé ma vie !
Et pour bien aller au fond des choses, voyons maintenant comment Vincenot, en visionnaire, parle de ce progrès, dont il sent déjà fermenter le goût amer et émaner les vapeurs morbides, celle d’une société d’auto-destruction que nous sommes tous aujourd’hui obligés de nous « farcir »… Tous ces effets délétères des avancées technologiques et scientifiques trop souvent détournées de ce qui devrait être leur seul but : le bien de l’humanité et de la terre, pour des raisons commerciales, belliqueuses, ou d’intérêt personnel. Odeurs d’essence, ondes maléfiques, destruction de la nature, zones commerciales et armes chimiques, atomiques et biologiques – à côté de trop peu d’autres, un tant soit peu utiles… Puanteur infecte que ce progrès futile (entre utile et futile, il n’y a qu’un f…) aux conséquences graves ! On est en plein Nino Ferrer : La maison près de la fontaine, a fait place à l’usine et au supermarché, les arbres ont disparu, mais ça sent l’hydrogène sulfuré ! L’essence, la guerre, la société… C’n’est pas si mal (toudoudoubidoudou) Et c’est normal C’est le PROGRÈS…
Voici donc la philosophie de la vie que se forge le jeune Henri au collège où il se frotte à des jeunes gens de tous horizons, goûts et couleurs – à l’humanité pour ainsi dire.
Pour commencer – chose que je m’abstiendrai de discuter ici – il en attribue toute la faute, non sans humour, aux « mathématiques, les mathématiques étant des exercices proposés à ces pauvres gens qui n’ont pas d’imagination. »
« Les groupes de promenade se constituaient au gré des affinités, car on pouvait « choisir sa promenade ». Or, tous les poètes, tous les rêveurs, tous les « littéraires », comme on disait, choisissaientcomme moi le groupe qui devait gagner les espaces rupestres, sylvestres, champêtres, les zones imprécises et inutiles, sans clôture, sans chemin, sans ciment et sans bitume. Les forts en mathématiques, au contraire, se trouvaient tous dans le groupe qui se traînait en ville sur le macadam et cherchait à voir passer des automobiles pour lescompter, fourrer leur nez dans le capot si par bonheur l’une d’ellesvenait à tomber en panne.
A tort ou à raison, je vis dans ce clivage naturel, quoique manichéen, le partage spontané de l’humanité en deux, dès l’enfance : d’un côté, les gens inoffensifs, de bonne compagnie, un tantinet négligents, mais dotés d’imagination, donc capables de savourer les simples beautés et les nobles vicissitudes de la vie de nature, et, de l’autre, les gens dangereux, les futurs savants, ingénieurs, techniciens, bétonneurs, pollueurs et autres déménageurs, défigureurs de empoisonneurs de la planète.
Certes, ce n’est que quelques années plus tard que je devais découvrir ce paradoxe bien celte, énoncé par mon frère celte Bernard Shaw : « Les gens intelligents s’adaptent à la nature, les imbéciles cherchent à adapter à eux la nature, c’est pourquoi ce qu’on appelle le progrès est l’œuvre des imbéciles ».
Je ne voudrais pas exagérer mes mérites d’adolescent mystique et imaginatif, mais, vrai, tout naïf que j’étais, je vis avec une grande netteté se dessiner le monde de l’avenir, celui que, tout compte fait, j’allais hélas être obligé de me farcir. Oui da ! dans ma petite tête de potache, petit-fils de pedzouille et pedzouille moi-même, j’ai pensé : « Si on continue à donner aux rigoureux minus, aux laborieux tripatouilleurs de formules, aux prétentieux négociateurs d’intégrales, le pas sur les humanistes, les artistes, les dilettantes, les zélateurs du bon vouloir et du cousu main, la vie des hommes va devenir impossible ! » (…)
Aujourd’hui, parce que l’on se désagrège dans leur bouillon de fausse culture, que l’on se tape la tête contre les murs de leurs ineffables ensembles-modèles, que l’on se tortille sur leur uranium enrichi comme des vers de terre sur une tartine d’acide sulfurique fumant, que l’on crève de peur en équilibre instable sur le couvercle de leur marmite atomique, dans leur univers planifié, les grands esprits viennent gravement nous expliquer en pleurnichant que la science et sa fille bâtarde, l’industrie, sont en train d’empoisonner la planète, ce qu’un enfant de quinze ans, à peine sorti de ses forêts natales, avait compris un demi-siècle plus tôt. Il n’y avait d’ailleurs pas grand mérite car, déjà à cette époque, ça sautait aux yeux comme le cancer sur les tripes des ilotes climatisés. (…) »
En vrai, un bilan qui sonne bien contemporain ! Mais Vincenot sait garder son humour :
« Les psychanalystes verront sans doute, dans cette attitude, une manifestation sénilede la rivalité qui opposa jadis le premier de sa classe en « Humanités », votre serviteur, et le premier en « Sciences » qui est devenu, comme on pouvait s’en douter, grand saboteur de la planète (…)
Il était là, devant le tableau, et vous torturait les X et les Y, vous les mélangeait, vous les pressurisait, vous les triturait, vous les superposait, vous les intervertissait, et selon qu’il leur donnait une valeur égale, supérieure ou inférieure à zéro, la courbe qu’il dessinait, je ne sais trop pourquoi, montait ou descendait sur l’échelle des abscisses. C’était effroyable !
Ce vide prétentieux, ce néant stérile et compliqué a duré vingt minutes et j’ai alors pensé : « Si on laisse ce gars-là en liberté dans la nature, eh bien, la nature est foutue, et nous avec! »
Vincenot le vieux raconte alors comment Vincenot le jeune, dans son esprit révolté par ce qu’il entrevoyait comme le grand malheur de l’humanité, élaborait des plans radicaux pour rétablir une sorte d’Inquisition, afin de protéger l’humanité contre « les gens trop malins, les sorciers et les apprentis sorciers*.« Il faudrait « arrêter le massacre, endiguer le génocide généralisé, mettre un terme à la fouterie scientifique et effondrer le château de cartes des fausses valeurs.« En somme, réduire à néant le même danger qui avait « toujours menacé l’humanité: la réussite des cuistres! »
* jouer à l’apprenti sorcier : entreprendre quelque chose à haut risque dans un domaine qu’on ne maîtrise pas. D’actualité ??
Cette Inquisition aurait pour rôle de stopper net toute invention diabolique et tuer dans l’œuf toute velléité de progrès scientifique qui pourrait s’avérer néfaste à l’homme ou à la planète :
« Un chevalier de l’extrapolation abusive, un Nicolas Flamel quelconque venait-il à découvrir un mécanisme de la cellule ou une structure de l’atome, un autre réussissait-il à imaginer tel merveilleux appareil à polluer le monde, on le prévenait d’avoir à arrêter ses mirifiques travaux: s’il persistait, c’était le bûcher en place de Grève. Terminé! Rien d’étonnant alors à ce que l’avion de bombardement, la mitrailleuse, les gaz asphyxiants, la dioxyne, les déchets radioactifs, les dérivés sulfonnés de l’azote non biodégradable, etc. aient mis si longtemps pour voir le jour. Que n’avait-on persévéré dans cette voie ! »
Constat désespérant et cruel, dont les conclusions horrifient Vincenot de son propre aveu…
« Vrai, on a fusillé et guillotiné des charretées de gens qui n’en avaient pas tant fait !
Je vous le demande, n’eût-il pas mieux valu raisonnablement neutraliser, en temps voulu, les futurs inventeurs de la mitrailleuse, comme le suggérait ma bonne grand-mère, et à plus forte raison les artisans de la fission de l’atome ou même du moteur à explosion ? Quelle économie d’atrocités aurait-on faite ! »
Il se dit « bouleversé en pensant qu’à quinze ans déjà, un bon petit élève des frères des écoles chrétiennes pût avoir d’aussi cruelles pensées, trois années seulement après cette « Première Communion » pour laquelle il avait juré de pratiquer l’amour total, le pardon total et le partage en Jésus-Christ, et de renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres…«
Mais sitôt dit, de repartir à la charge:
« … Mais les pompes et les œuvres de Satan, n’étaient-ce pas précisément les mathématiques ? La science ? Symbolisée par cet arbre de science, au cœur du paradis terrestre où Satan incite l’homme à cueillir le fruit « défendu » d’où vient tout le malheur des hommes ? Quel symbole !
Non, vraiment, l’on ne peut pas dire que nous n’étions pas prévenus ! «
L’on ne peut pas le dire, en effet. La boucle est-elle ainsi bouclée, le serpent du progrès va-t-il enfin se mordre la queue ?
Ces constats sont cruels, mais non dénués de bon sens ni de réalisme : l’avenir (c’est à dire notre présent d’aujourd’hui), lui donne raison. Nous allons, toujours plus, vers la catastrophe écologique, faite de main d’homme. Tout est à l’envers : le haut est en bas et le bas est en haut. On fait semblant de protéger la vie des plus vulnérables (migrants, pays pauvres, personnes âgées, vaccins), mais au nom des droits de la femme, on encourage l’avortement jusqu’à terme (voir les directives de l’OMS de 2022*). On a détruit le génie français, découragé l’artisanat, déconsidéré les filières humanistes ou techniques au profit des études longues et scientifiques, mais on importe des gadgets de qualité nulle des quatre coins du monde et certaines de nos technologies de pointe (nucléaire et traitement des déchets, aéronautique, TGV) se noient dans le bouillon mondialiste. On nous assène des dogmes écologiques à tire-larigot mais on nous fait consommer des aliments venus en avion ou en cargo du bout du monde, dont les modes de production nous échappent. On produit des biens à obsolescence programmée et on nous encourage à sur-consommer, créant des déchets plastiques, métalliques et électroniques qui suffoquent la planète. On nous dit que la science et la technologie vont nous libérer, mais on nous enferme dans la peur, toutes les peurs : celle de manquer, celle d’être malade, la peur de ne pas se conformer au modèle sociétal… On nous enjoint de tout numériser, mais les serveurs internet sont les plus gros consommateurs d’énergie électrique de la planète et les antennes mobiles défigurent nos paysages. On pollue le corps humain et la nature de pesticides, métaux lourds, nano-particules et ondes électromagnétiques qui dérangent l’ADN et le tissu vivant, mais on nous explique que c’est pour le bien de l’humanité, au nom d’un développement toujours plus acharné qui en fait n’est qu’une course illusoire à vouloir exploiter, s’approprier et régimenter le vivant, tout en ne profitant qu’à une poignée de gras milliardaires boulimiques* qui dominent la planète. Notre vie est pleine à ras-bord de ces paradoxes, mais beaucoup d’entre nous ne les voient pas, endoctrinés par les médias, la publicité mensongère et les dogmes d’État.
* comme le monstre dans Le voyage de Shihiro
Comme des lémuriens au bord de la falaise, (une certaine partie de l’humanité) n’a plus le choix que de sauter. (Une autre se réveille et recommence à rêver d’un autre monde, à vivre simplement, avec sobriété et des valeurs authentiques…)
Serait-ce la destinée de l’homme, que d’aller jusqu’au bout de l’horreur, de la déshumanisation, jusqu’aux racines du mal (exhibé comme dieu en place publique), voire même, de s’auto-détruire, pour qu’enfin puisse se re-présenter à nous le choix originel : une autre chance de choisir une autre voie – celle du respect de la vie, celle d’un émerveillement devant le mystère du vivant qui nous dépasse et échappe à nos manipulations, celle de notre petitesse et notre humilité, celle de vivre une entente profonde avec toute la création ?
Le moment est venu de choisir son camp
Pour conclure ce chapitre sur la vie moderne, le modèle cristallisé dans les villes et l’avenir de l’humanité, faisons une dernière petite incursion dans un roman d’Henri Vincenot que je n’ai pas mentionné jusque là – bien qu’il en vaille vraiment la peine. Il s’agit du Maître des abeilles, son tout dernier roman signé du 26 octobre 1985, soit un mois avant sa mort. Le Maître des abeilles devait être le premier d’une trilogie sur des chroniques de la vie d’un village bourguignon, trilogie qui n’a donc jamais vu le jour.
Dans ce merveilleux petit fascicule, Vincenot y présente à la fois une vie à la campagne romantisée et idéalisée – les poules, les abeilles, les cloches du bedeau, les balais de genêt, les treuffes (patates) et une communauté qui s’entraide et qui partage le repas de Pâques dans l’église…. et aussi une critique acerbe et drôle de la vie parisienne, à travers une famille, dont le père redécouvre les trésors oubliés de leur maison ancestrale en Bourgogne. Pendant ce court séjour à la campagne, le fils, Loulou le drogué, vient y cuver ses overdoses et retrouve goût à la vie en s’initiant à la culture des abeilles avec le Mage, personnage haut en couleur comme il y en a dans chaque roman de Vincenot.
L’écrivain exploite le contraste ville /champs pour tirer à vue sur la société post-soixante-huitarde, les étudiants en sociologie, le MLF, les transports routiers et les bouchons, la drogue, les couples qui s’ignorent et s’éloignent impitoyablement l’un de l’autre… les mères « libérées » qui se targuent de réussir leur carrière et délaissent leurs familles pour aller se casser la jambe au ski aux vacances de printemps… les adolescents en quête de sens et en manque d’affection … C’est une satire délectable et sans compromis du mode de vie « moderne » qui émerge déjà comme normalité dans les années 80.
Je ne puis m’empêcher de vous en donner un avant-goût.
C’est le lundi de Pâques, le soir. Comme un bon petit soldat, Louis Châgniot (de châgne, le chêne) rentre de son week-end de Pâques en Bourgogne, pour « reprendre son service » comme il dit gravement.
« – Peuvent pourtant bien se passer de toi à Paris ? répliqua le Mage, qui n’avait jamais connu d’obligation de ce genre, ni compté le temps ou l’argent.
– Et qui me paierait au bout du mois ?
Le Mage hocha tristement la tête en disant :
– C’est vrai qu’ils te tiennent comme esclave, là-bas. «
Louis Châgniot donc, après avoir cherché en vain son fils – qui s’est planqué dans les fourrés pour ne pas retourner à Paris – arrive sur le périphérique.
« Quelques minutes avant vingt-trois heures, Louis Châgniot débouchait sur les boulevards extérieurs au droit de la porte d’Italie parmi un peu moins de cinq cent mille chevaux fiscaux, rongeant leur frein de devoir marcher au pas sur cinq files. Il sifflotait car il avait réussi à éviter ainsi le bouchon intégral du lendemain de fête.
Aspirant à pleins poumons les gaz d’échappement de ce troupeau piétinant, le pied jouant alternativement du frein et du débrayage et tout en réussissant quand même à faire du quatre à l’heure, il supputait qu’il arriverait rue Sauvage avant les minuit, ce qui était, tout compte fait, une heure très raisonnable pour un enfant du peuple devenu cadre supérieur à la force du poignet. »
Là, je retrouve l’humour affûté du Mon oncle de Jacques Tati : la ménagère et sa cuisine automatisée, son jet d’eau qui démarre (ou pas) à chaque fois que quelqu’un sonne à la grille du jardin… ses escarpins qui font clic clic sur les dalles savamment agencées pour traverser le jardin sans enfoncer ses talons aiguille dans la terre… un mari complet-veston-cravate qui ne la regarde plus et part à l’usine toujours à la même heure, répétant les mêmes gestes chaque matin pour sortir la voiture du garage (sauf lorsque la porte de celui-ci se coince) … les invités « de marque » qui parlent tous en même temps et ne s’écoutent pas… Dans cet univers aseptisé, sans vie, un petit garçon ne se trouve à l’aise que lorsque débarque son oncle, qu’il adore – fantaisiste, imprévisible, au vieil imperméable râpé, qui vit dans un boui-boui tout de guinguois sur la terrasse d’un immeuble montmartrois et qui l’emmène faire des balades dans la carriole à âne du chiffonnier… Tout le bonheur enchanteur d’un monde encore magique et poétique, comme dans un film de Charlot, qui s’affronte au modernisme matérialiste lorsque l’oncle doit prendre un job dans l’usine de plastique… où il ne fera que des bêtises, tout mal adapté qu’il est à ce monde moderne !
Alors, comment en est-on arrivé là ? Est-ce la science des lumières et l’esprit rationaliste qui ont voulu tout orchestrer et faire taire la magie du monde ? Modernisme semble en effet rimer avec urbanisation, progrès, électrification, numérisation, automatisation, modélisation… tout ce à quoi s’oppose farouchement la vie dans son imprévisibilité, dans sa sauvagerie, dans ses manifestations erratiques ou joyeuses, la vie telle qu’on la retrouve – encore – un peu plus facilement à la campagne.
Cette fracture se retrouve-t-elle, aussi, en chacun de nous ? Sommes-nous chaque jour tentés d’adhérer à ce monde du progrès et de la croissance, à cette croisade technologique et scientifique dont on peut constater qu’elle ne résout pas les problèmes de l’humanité ? Attirés (comme des mouches sur un leurre aux phéromones), hypnotisés, aveuglés, neutralisés par les distractions, les jeux du stade, les gratifications distribuées avec suffisance par des autorités auto-proclamées qui alternent brimades et mortifications et ne veulent pas forcément que notre bien ? Ce modèle mortifère ne perdure-t-il pas par nos propres reniements et nos compromissions qui nous éloignent de notre vraie nature, celle qui est lumière, amour, celle qui n’exclut pas, qui ne catégorise pas, qui ne juge pas ? Vendons-nous, un peu plus chaque jour, notre âme au diable ? Combien de concessions aurons-nous faites à la modernité, avant de nous rendre compte de ses limites, de ses insuffisances à créer le bonheur, et de ses maléfices, avant de faire marche arrière ? Il ne s’agit pas d’être passéiste, mais bien au contraire, de se tourner vers l’avenir, le sourire aux lèvres et confiant dans un avenir qui peut être radieux; de tourner le dos à tout ce qui va à l’encontre de notre bien-être et de nos convictions profondes et réveiller, en nous, le goût des vraies valeurs, la pulsation d’une vie qui vibre à l’unisson avec le monde, le sang rouge de nos racines spirituelles, qui sonne juste et beau.
Je ne puis m’empêcher d’être un brin optimiste en voyant, dans les jeunes générations, certains qui aspirent à un avenir plus équilibré, plus respectueux de la vie, plus heureux… mais le combat est rude car une autre jeunesse ne vit que le visage plongé dans les écrans, la paresse de penser pour soi-même et les préceptes d’une nouvelle religion médicale et étatique, les automatismes d’un nouveau culte : celui de l’algorithme et de la répétition à l’identique – sauf que la Vie avec un grand V ne peut être ni contrainte, ni manipulée. Alors, peut-être serons-nous là pour voir le visage d’un nouveau monde meilleur, peut-être pas. Je ne fais que le constat, et ne me fais que la porte-parole des aspirations de nombre de nos contemporains, qui n’ont pas perdu le sens et le désir de la vraie vie : celle qui fait rire, être joyeux, généreux, s’épanouir et s’accomplir, être en phase avec son destin, en accord avec le monde et les autres, émerveillé de la magie des énergies créatives qui se manifestent à chaque instant… Et alors les faiseurs de misère, les esclavagistes, les égoïstes et les dominateurs (et la part de nous qui adhère à cela), ceux qui voudraient que l’on ne pense qu’à payer des taxes, baisser la tête et rentrer dans le moule en silicone tout chaud qu’ils ont prévu pour nous, encaisser les coups, ne plus réfléchir et dire amen à toutes leurs injonctions, peut-être ceux-là n’auront-ils plus de prise sur nous… car leur rêve à eux sera parti en fumée, effondré sous ses propres paradoxes, devenu obsolète. Il faut confronter cette réalité, cette noirceur – à l’extérieur comme à l’intérieur de nous – l’intégrer et la transformer.
Quelques lignes sur cette prise de conscience intérieure :
« Un combat quotidien. Dans un texte de 1939, Mahātmā, A.K.Coomaraswamy précise que dans une époque très ancienne, on trouvait dans un sutta Bouddhique la distinction entre le « Grand Soi » (mahātmā) et le « petit soi » (alpātmā) de l’homme. Ce qui pour A.K.Coomaraswamy correspond à la distinction effectuée entre esse et proprium (à l’être et à la propriété comme qualités psychophysiques) de Saint Bernard. A travers l’exemple mythologique rencontré aussi bien dans les textes védiques, que dans la mythologie grecque, de la lutte entre les Dieux (deva) et les Titans (asura), il démontre le combat continu de l’être humain. Où tout être est toujours en guerre avec lui-même. Il faut alors parvenir à comprendre et à expérimenter ce combat entre les deux « soi ». Entre le « soi » de la petite personne et le « Soi » divin. Entre le composé corps-esprit et l’Esprit (Souffle. pneuma). Il demande au lecteur d’effectuer l’expérience d’un tel combat, comme il le faisait lui-même.
« Comment la victoire peut être gagnée en ce Jihad ? Notre soi, dans son ignorance et son opposition au Soi immortel, est l’ennemi qui doit être vaincu. La voie est celle d’une séparation intellectuelle, sacrifice, et contemplation, supposant toujours en même temps les conseils des précurseurs. » (A.K.Coomaraswamy. Sur la psychologie, ou plutôt pneumatologie, dans l’Inde et dans la Tradition.) » **
Le shivaïsme du Cachemire lui, avance qu’il n’y a même pas à proprement parler de « combat » à mener. Simplement être là, présent à cette réalité, être attentif à toutes les ramifications de nos postures intérieures et extérieures, à la structure de la société qui reflète nos tergiversations et, de l’attention fine, de la présence aimante, découleront des modifications naturelles de notre comportement.
Avec l’éveil des consciences, le monde moderne qu’ils (les petits « soi ») ont voulu monter de toutes pièces est déjà mort et c’est à nous (les « Soi » divins) de dessiner les contours de celui qui, petit à petit, sortira de la brume pour émerger en une nouvelle aube.
(c) D. M. automne 2023
photo de couverture (c) DM: poudres de perlimpinpin aux hospices de Beaune : un clin d’oeil à la pharmacopée médiévale, peut-être pas si stupide que cela ?
* OMS / avortement
Les directives de l’Organisation mondiale de la santé, publiées en 2022, préconisent la « dépénalisation de l’avortement jusqu’au terme de la grossesse » dans tous les pays du monde et vont même jusqu’à indiquer des préconisations médicamenteuses et chirurgicales pour accomplir un avortement après 19 semaines.
Voir les directives complètes en français ici : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240039483
et le résumé en français ici :
https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240045163
–> Une analyse critique de ce document « plus idéologique que scientifique », ici :
https://www.genethique.org/loms-recommande-lavortement-a-la-demande-jusquau-terme/
** la guerre du « soi » et du « Soi »
dans https://axecosmique.wordpress.com/2022/12/25/a-k-coomaraswamy-il-y-a-deux-soi-en-nous-2/
et
Se détourner du Ciel sous prétexte de conquérir la terre
Voir aussi cet article sur le Moyen-Âge et la décadence du monde moderne, commentaire sur un extrait de René Guénon dans « La crise du monde moderne » (sur le même blog Axe cosmique)