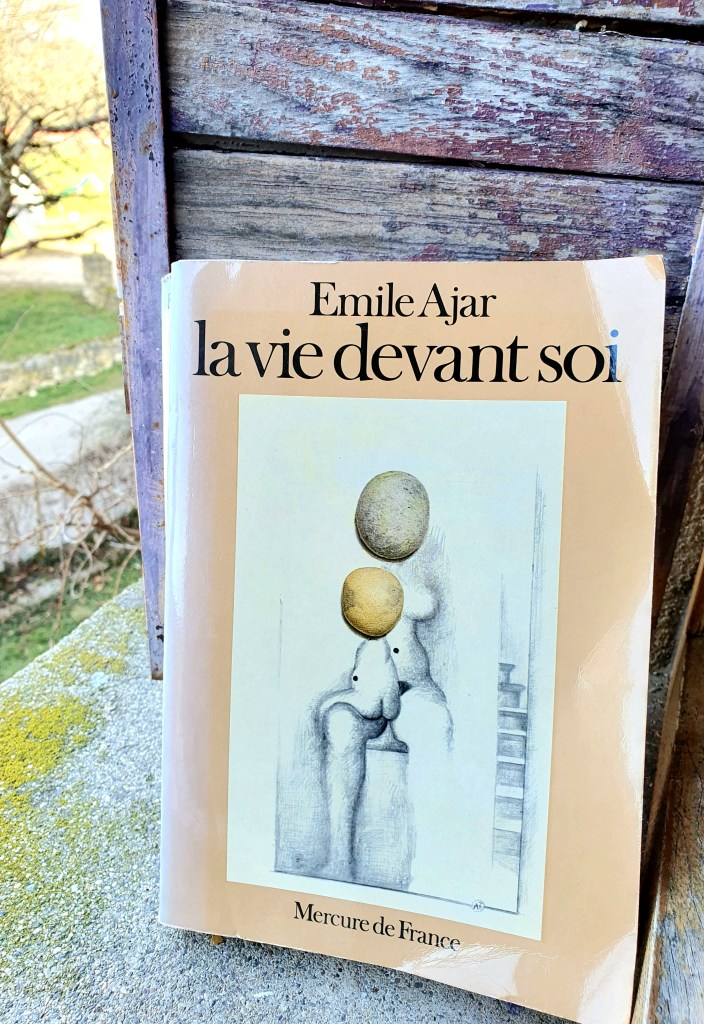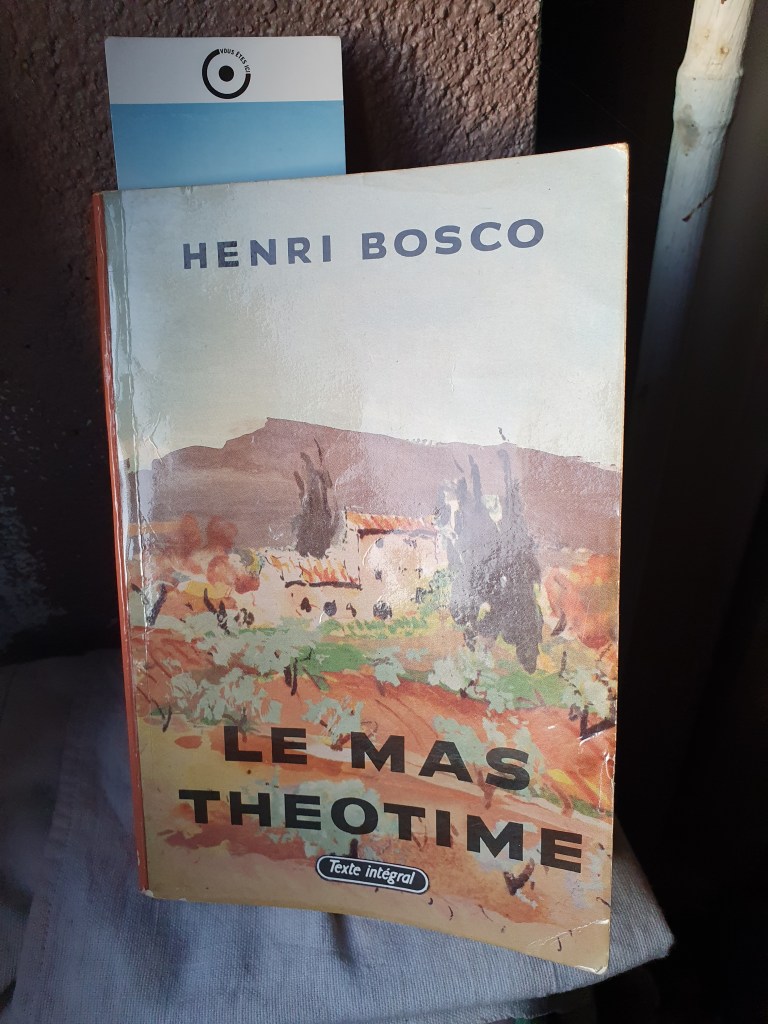Le seigneur du fleuve, splendeurs et misères des mariniers
Nous sommes à Lyon, en 1840. Chez les bateliers du Rhône, qu’une longue période de sécheresse a contraints à l’immobilité, on ronge son frein. Pour ces gens du voyage, qui travaillent et vivent sur l’eau, rien n’est pire que l’immobilité. Rien ? Si, peut-être : l’ère du feu et du fer qui, après avoir apporté sur terre les chemins de fer, menace leur commerce avec de gros bateaux à vapeur, qui peuvent descendre et remonter le Rhône en quelques jours.
« Car ce temps-là était fait d’inquiétude. Depuis que la vapeur tirait des voitures sur un chemin de fer et poussait sur l’eau des bateaux de métal, il semblait que le pain cesserait un jour d’être à la portée de tous. Il ne suffisait plus de connaître son métier et d’avoir de l’ardeur pour être assuré de vivre. Il y avait une menace qui ne venait plus du ciel, mais des hommes. Et l’on s’apercevait avec étonnement que la folie des humains est plus dangereuse que celle qui secoue les éléments parce qu’elle dure davantage. »
Or, nos bateliers vivent du transport des marchandises, soie, vin, matériaux de construction. Ils sont organisés en grandes familles, patrons de rigues (propriétaires d’un convoi de barques plates) ou engagés comme mariniers, intendants, cuisiniers, charretiers et mariniers de terre pour mener les chevaux de halage. Ils voient d’un mauvais œil cette époque qui change et leur amène une concurrence déloyale, qui vient détruire toute une économie qui fonctionne autour des hommes du fleuve : les ports, les auberges, les fermes, les chevaux, les rameurs, les prouviers qui sondent le fleuve à la proue, surveillant les bas-fonds, les bancs de sable qui se meuvent avec les caprices du fleuve, les courants et les reflux. Les hommes du fleuve sont mariniers de père en fils et tirent fierté de leur métier; ce sont les hommes les plus forts, charpentés, à la fois navigateurs et transporteurs, capables de soulever une caisse de bois sur leur dos et de la porter à quai. Ce sont eux qui connaissent le mieux le fleuve et ses caprices, mais aussi savent interpréter le ciel et prévoir ses humeurs. Ils en tirent les conséquences pour la navigation, savent quand partir et quand s’arrêter. Ils ne rechignent pas à la peine, ne demandent rien à personne, gagnent leur vie honnêtement et embauchent lorsqu’ils sont patrons, ils se connaissent tous et se saluent respectueusement, ils ont en commun cet amour de leur métier : bref, ce sont de fiers et honnêtes travailleurs.
Le temps du fer
Ce roman de Bernard Clavel se situe à la charnière d’une époque où l’on commence à voir les innovations technologiques perturber un équilibre jusque là assez simple.
« C’était le temps du fer. Ceux des forges et des ateliers s’en réjouissaient. Ceux des hauts fourneaux aussi qui allumaient dans les nuits de toutes les saisons des lueurs d’incendie, et couchaient sur les campagnes et les villes des fumées qui salissaient tout. (…)
Le fer sur le fleuve, le fer sur les chemins, le fer sur les rails de fer, bientôt les maçons aussi seraient en chômage s’il prenait l’idée aux grosses têtes de faire construire des maisons de métal. »
Chaque patron de barque a peur pour son avenir et celui de sa famille, de toutes les familles qu’il fait vivre. De nombreux attelages ont déjà été vendus, barques et chevaux, tant que l’on pouvait encore en tirer un bon prix. Des mariniers se sont repliés chez eux, exilés ou ont, à contrecœur, changé de métier. Certains, mûs par le sens du progrès, ou par l’attrait du nouveau, partent travailler pour les Compagnies de bateaux à vapeur : on les considère comme des traîtres. Mais l’avancée du monde est forte comme le fleuve…
« Malgré tout, le courant allait. Ce courant de la vie qui est toujours pareille à un fleuve. Des remous se forment. Ils font remonter une partie de l’eau qui semble vouloir reprendre le chemin de sa source. Mais le fleuve continue tout de même de couler et finit par tout entraîner à la mer. Il y avait de plus en plus de vapeurs et de moins en moins d’équipages. Les voyageurs, au départ de Lyon pour la descente et de Beaucaire pour la remonte, prenaient tous des bateaux à feu. Il ne restait à la batellerie que les voyageurs s’embarquant dans les ports où les vapeurs n’accostaient pas. Pour les marchandises, on devait tirer les prix et, là encore, c’était la guerre. Une guerre qui opposait les patrons d’équipages aux responsables des grands compagnies.
Ces compagnies-là étaient des monstres. Plus du tout des hommes. Tant que l’on se bat contre des gens, on sait à peu près où on va. Mais ce n’était pas le cas. Ces gens-là disaient toujours : La Compagnie a dit. La Compagnie a fait. La Compagnie a décidé. Moi, je n’y suis pour rien.
Ils avaient plein la bouche de cette Compagnie qui semblait échapper aux lois humaines. C’était une espèce de monstre dont le ciel avait accouché sans que l’homme y fût pour rien. »
Philibert Merlin est patron de rigue, il possède un train de sept barques – dont la plus grande mesure quarante-cinq mètres. Vingt-huit chevaux de remonte, vingt-trois hommes à sa charge – tous, chefs de famille. Chaque barque a son capitaine, son prouvier, son mousse; certaines contiennent les écuries pour les chevaux, les charretiers… tout un microcosme qui avance sur l’eau et regarde le monde terrestre avec une joie distanciée, teintée parfois de dédain.
Son père Félix était marinier, son fils Claude est aussi embarqué dans sa rigue. Philibert a beau être l’un des meilleurs, le meilleur peut-être, il est inquiet pour l’avenir de toute cette tribu dont il est le chef. Il va tout faire pour faire ralentir l’inéluctable, faire reculer l’échéance. Il va chercher à prouver que rien ne remplacera la navigation artisanale, qui a ses lettres de noblesse, plus souple, silencieuse et qui ne pollue pas et génère, dans tous les ports qu’elle traverse, un évènement, des fêtes de village, de la joie.
« Depuis des siècles, les bateliers faisaient vibrer les rives. Chevaux, coups de gueule, coups de hache, ils n’épargnaient rien et ne respectaient que le fleuve. Mais tout ce qu’ils faisaient était dans l’ordre des choses. Tout s’inscrivait dans le grand mouvement du fleuve. Avec la vapeur, c’était autre chose. Les bateaux étaient si gros et si rapides que lorsqu’ils passaient, toute l’eau qu’envoyaient vers l’arrière leurs énormes roues (à aube) manquait soudain au fleuve qui se vidait de moitié. Brusquement découvertes, les grèves et les digues offraient à la vue de n’importe qui le secret de leur vie. Les millions de bêtes qui vivent dans les mousses, sous les graviers, sous les racines, entre les roches, s’affolaient. Les poissons restaient le ventre sur le sable. Et puis, le bateau passé, c’était la folie de l’eau durant un bon quart d’heure. Tout était bousculé, remué, trempé, brassé et saccagé. La vase des mouilles montait en surface et filait vers le large en longues traînées brunâtres. La graisse des bielles, la fumée, les cendres, tout contribuait à empoisonner bêtes et gens. Depuis deux ans, on ne voyait presque plus de castors dans les îles. Des peupliers étaient tombés, minés en dessous par ce flux et ce reflux qui n’étaient pas dans la nature du fleuve. »
Une lutte acharnée
Or voici qu’après la sécheresse, advient la première pluie qui va permettre à Philibert de prendre le départ – bien avant le vapeur qui a besoin de davantage de hauteur d’eau. Il peut descendre sur Avignon puis Beaucaire – le terme habituel de la décize (la descente) avant de tenter la remonte, chargé à bloc de marchandises, dans un sens comme dans l’autre. Mais voici qu’après les premières pluies tranquilles s’abattent des pluies diluviennes, soudaines et violentes, qui vont provoquer une crûe monumentale, la crûe du siècle en novembre 1840 (Clavel a dû s’inspirer de faits réels puisque cette crûe du siècle est documentée et a dû faire l’objet de chroniques et récits dans les journaux et archives de l’époque). Dans une tentative désespérée de parvenir à ses fins – prouver que la navigation fluviale a encore un avenir, tenter de tuer dans l’œuf la navigation à vapeur qui bouscule tout – tandis que tous les autres restent à quai, Patron Merlin va tout de même tenter la remonte. A contre-courant, sur un Rhône de plus en plus violent, charriant de plus en plus de débris, branches, poutres, meubles et pans de maisons noyés, bateaux lavoirs effondrés, arbres entiers ballottés au gré des courants et des contre-courants, sur les chemins de halage où les chevaux peinent avec de l’eau presque jusqu’au poitrail, il va s’acharner, entraînant derrière lui tous ceux qui lui sont fidèles et loyaux. S’acharner, bien sûr, jusqu’au drame.
Ce livre nous invite à une réflexion sur le progrès. De tout temps – c’est une ritournelle bien connue – on nous a promis que les machines, les innovations technologiques allaient soutenir et aider l’homme, augmenter l’amplitude et l’impact de ses actions, améliorer son quotidien, ses conditions de travail, le confort et la facilité… Mais à quel prix ? A-t-on jamais vraiment mesuré l’impact destructeur et le potentiel de malheur que chaque vague de progrès et d’innovations a apporté au monde ? Ce n’est le plus souvent qu’après coup (rarement avant), que l’on se rend compte que les choses ne sont peut-être pas aussi positivement tranchées. Et alors se repose, incessamment, la même question : à qui ce progrès profite-t-il réellement ?
Dans notre cas, certainement pas à ceux qui ont vu, avec tristesse, disparaître engloutie dans les remous du fleuve toute une belle économie de navigation à rames et à barques sur le Rhône, qui permettait de transporter, lentement mais avec bonheur, personnes et biens et donnait un travail honnête, digne et satisfaisant à tout un peuple de bateliers, de mariniers, et aux aubergistes et riverains des petits ports qui parsemaient les rives du Rhône sous Lyon.
« Quitter le pays, certains l’ont déjà fait. D’autres se préparent à le faire. D’autres encore qui ont voulu s’y accrocher ont dû changer de métier, mettre en vente une belle maison pour se loger dans trois fois rien. Se loger avec leur famille, et leur tristesse. Des gens fiers qui se cachent aujourd’hui comme s’ils avaient fait un mauvais coup ou contracté une sale maladie.
Ceux qui se souviennent du choléra disent que la vallée sent la même chose qu’avant l’épidémie. Ils disent « la même chose » parce qu’ils n’osent pas employer certains mots. Et quand ils disent « elle sent », ce n’est pas d’une odeur qu’ils parlent, c’est de ce que personne ne peut ni voir, ni toucher ni définir. Un malaise. Une sorte de mystère qui tue la joie. »
David et Goliath, les leçons de l’histoire
N’avons-nous pas de même, aujourd’hui, à endurer les vagues de ce « malaise qui tue la joie » causées par la quatrième révolution, la révolution numérique ? Ne sommes-nous pas rendus dingues par ces formalités incessantes, autorisations de prélèvements, doubles validations ? Par ces réseaux sociaux qui ont remplacé le café du coin et le dîner en famille ? Ne sommes-nous pas assommés par la bureaucratie et son besoin de tout fonctionnariser, enregistrer, contrôler, mettre en boîte, à la manière du film Brazil ? Ne sommes-nous pas abrutis dans notre potentiel de réflexion, dans notre potentiel créateur, par l’intelligence artificielle, notre cerveau n’est-il pas rendu à l’état de légume bouilli par ces ondes perverses et invisibles qui peuplent nos domiciles, nos transports, nos lieux de travail et même de villégiature et qui peut-être nous influencent ? Et ne sommes-nous pas avilis, réduits à l’état de robots, asservis par l’iétau qui se resserre, nous enjoignant de nous conformer à des procédures, des réglementations, jusque dans nos pensées, nos modes de vie, nos aspirations légitimes ? Et dans ce méli-mélo délétère, nous posons-nous la bonne question : à qui tout cela peut-il bien profiter ? Et quelle place ont encore la joie, le mystère, l’imprévu dans nos vies ?
Clavel dépeint avec lyrisme ce monde disparu.
« Ils étaient les plus enviés et les plus respectés de la vallée, parce qu’ils la faisaient vivre et aussi parce que chacun savait que, pour être encore là, ils avaient dû lutter sans cesse avec le fleuve, tout perdre et reconstruire à plusieurs reprises. Ruinés par le Rhône lorsqu’une crue détruisait tout un train de barques et noyait les chevaux, c’était au Rhône qu’ils demandaient secours pour recommencer. Ils étaient trop orgueilleux pour se plaindre. Ruinés, ils recommençaient avec une ou deux barques. Ils avaient pour eux un nom qui était connu de Lyon à Beaucaire. Ils avaient la confiance. Ils avaient le courage et une connaissance du fleuve qui tenait davantage de l’instinct de la race que de ce que les êtres humains peuvent se transmettre. »
Après avoir consacré les premières pages à la vaillance et la fierté de ces mariniers, reprenant la navigation après un mois d’immobilisation dans le cours du fleuve asséché, il nous embarque pour l’aventure. Car avec la reprise, plane l’ombre de l’échec face aux grosses Compagnies, le combat de David contre Goliath, et revient l’amertume de la concurrence déloyale des bateaux à vapeur, le progrès qui est venu leur prendre leurs meilleurs hommes, détruire les berges et toute la faune et la flore qui constituent le biotope (au grand dam des vrais écolos !) et remodeler le paysage autour de ports modernes et sans charme, et de vagues de fumées noires qui assiègent les vignobles. Sans compter les innombrables obstacles administratifs qui s’accumulent :
« Sur tous les ports on construisait ou on agrandissait les bâtiments d’administration. Les bureaux y tenaient chaque jour davantage de place. Tous ces gens assis, pâles et chétifs, amusaient les mariniers, mais c’étaient eux qui faisaient la loi, et ça, c’était plus agaçant qu’amusant. C’était encore une invention des gens de la vapeur pour compliquer la besogne des batteurs d’eau et les contraindre à payer des taxes supplémentaires.
Car les assis, même s’ils n’ont pas aussi fort appétit que ceux qui produisent, il faut tout de même les nourrir. Et ce sont les travailleurs qui les nourrissent.
Non seulement les mariniers devaient payer pour que ces fainéants puissent manger à leur faim et se vêtir de chemises empesées, mais encore ils étaient tenus de leur faire leur travail. Car les papiers, c’étaient les conducteurs de rigues qui devaient les remplir. Et les conducteurs avaient beau être savants, comme ils étaient presque tous très âgés, ils avaient bien du mal à saisir les subtilités de ces nouveaux règlements.
C’était ce qu’on appelait le progrès. On compliquait à plaisir la tâche de tout le monde après avoir clamé sur tous les toits que la vapeur allait permettre aux gens de vivre mieux en peinant moins. Beau résultat ! On ne pouvait plus transporter du café, du savon, du vin sans remplir des formulaires compliqués que devaient vérifier et enregistrer les gens du bureau de navigation et de jaugeage.
Même le préfet venait mettre son nez dans les affaires de la navigation ! Comme si ce rond-de-cuir pouvait avoir une idée de ce qu’était une barque ou un port ! »
Le héros tragique
« Les mariniers étaient de ceux qui lèvent les amarres dans les matins où tout départ est un défi. Leur foi était solide, ils croyaient en leur métier, et savaient se forcer à l’espérance. Quelque chose leur disait que la machine peut donner à l’homme un pouvoir immense, mais ils répondaient que ce pouvoir n’est rien, puisqu’il dépasse l’homme. Ils sentaient bien que la machine transforme ceux qu’elle a conquis, et ils tenaient à demeurer des hommes libres. Tandis que d’autres forgeaient les pièces des machines qui feraient d’eux des rouages, ils se levaient très tôt dans des aubes sans lumière, pour forger un espoir qu’ils poussaient devant eux sur le fleuve. »
Philibert, le héros, connaît les faiblesses de son ennemi. Il sait que s’il parvient à remonter – tandis que les gros bateaux à vapeur, qui certes vont plus vite et transportent davantage, mais restent coincés si le niveau d’eau est trop haut sous les ponts – il aura prouvé que la navigation artisanale a encore de beaux jours devant elle. Et il est prêt à tout, au péril de sa vie, pour cette cause qu’il estime la sienne, mais aussi celle de tout une clan qu’il défend avec âpreté.
Ce livre est aussi une réflexion sur l’orgueil, et les risques qu’il nous fait prendre.
« Leur métier, c’était la domination. Savoir être au-dessus des autres. Plus fort physiquement, plus intelligents, plus riches aussi puisque c’était le patron possédant le meilleur équipage qui accomplissait la meilleure besogne. Dominer les autres patrons, dominer leur propre équipage et, surtout, dominer le fleuve.
Pour un pareil métier il faut de la force, mais il faut aussi de l’orgueil. Un immense orgueil. »
Patron Merlin va prendre la remonte, en dépit des conseils avisés et même de quelques signes du destin qu’il aurait pu mieux interpréter. Il se sent mû par une force invincible, une idée fixe, investi d’une mission plus haute que lui : trop grande, sans doute. Il se veut le vainqueur de la vapeur, le résistant d’une époque, le héros d’une tribu en voie de disparition. Certes, il aurait pu vaincre : il ne s’en est tenu qu’à une maille de chanvre qu’il ne réussisse son exploit, et alors, il serait resté dans l’histoire comme le plus valeureux des patrons de rigue, celui qui a fait – un temps peut-être – reculer la vapeur. Mais ce faisant, il en oublie ceux qui dépendent de lui et dont il est responsable. Il est tout imbu de sa tâche glorieuse, et si les circonstances, les évènements ne le font plus reculer, il atteint un point de non-retour qui frise le sacrifice.
Plaisir de lire
Ce récit noble et libre nous vaut, dans un français à la fois poétique et précis, de belles pages sur le fleuve et la nature, de fines analyses sur la psychologie et les rapports humains : l’honneur, la peur, la joie, la rivalité, la rage, la haine, l’orgueil, l’entêtement, la responsabilité. De belles pages fleuries d’un vocabulaire typique de la navigation fluviale, totalement inattendu et dans lequel on se noie avec délectation, tant il rappelle un monde oublié, une citadelle engloutie : un agotiau (une écope), un arbouvier (mât très court et robuste au tiers avant du bateau, qui sert pour le halage), les mailles (cordes d’amarrage), les vorgines (végétations folle sur les rives des îles), les lônes (bras morts du fleuve), les meuilles (remous causés par un contre-courant), un pan de profondeur (une main ouverte)… Mais aussi les barques : les penelles aux extrémités relevées, les seysselandes fabriquées à Seyssel avec leur avant pointu et leur arrière carré; les savoyardes toutes plates, la penelle civardière qui porte les écuries des chevaux…
Terminons avec cette jolie évocation de la nuit, après un soir de fête à Beaucaire :
« C’était une nuit où la vie du ciel tenait plus de place que la vie de la terre. Tant que la fête avait mené son branle de lumière, de musique et de bruit, les hommes en groupe avaient continué de croire qu’ils étaient la seule vie de la vallée. Et puis, la musique et les lumières éteintes, partant chacun de son côté, tous avaient senti peser la présence du ciel.
Le fleuve, les arbres, les prés, les champs, les ponts, les bateaux, les maisons, rien ne dormait comme les autres nuits. Il y avait partout des rêves agités, de longues plaintes et des soupirs. C’était une de ces nuits où le ciel fou fait l’amour avec la terre. L’amour plein de violence, un peu sauvage, à goût de lutte. Pas une étoile qui demeure sans trembler, par un pouce carré d’eau morte qui continue de dormir.
C’était une nuit bien plus vive que les jours qui venaient de s’étirer sur la terre dans la grande chaleur immobile et lourde. La chaleur demeurait, mais elle s’était mise à courir avec le vent. Elle chassait le peu de fraîcheur que les arbres les moins dépouillés avaient su garder à l’intérieur de leurs grands corps tremblants.
Demain, il n’y aurait plus d’ombre fraîche. »

Robert Laffont, 1972
texte (sauf les citations) et photos, (c) DM novembre 2024
photo de couverture : musée égyptien de Turin