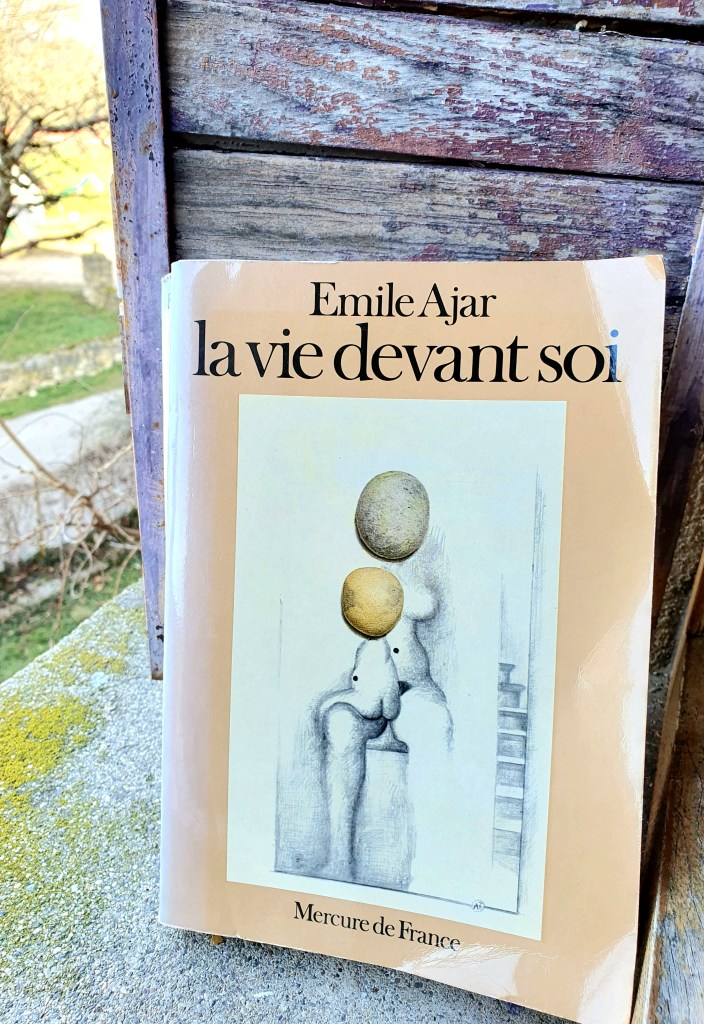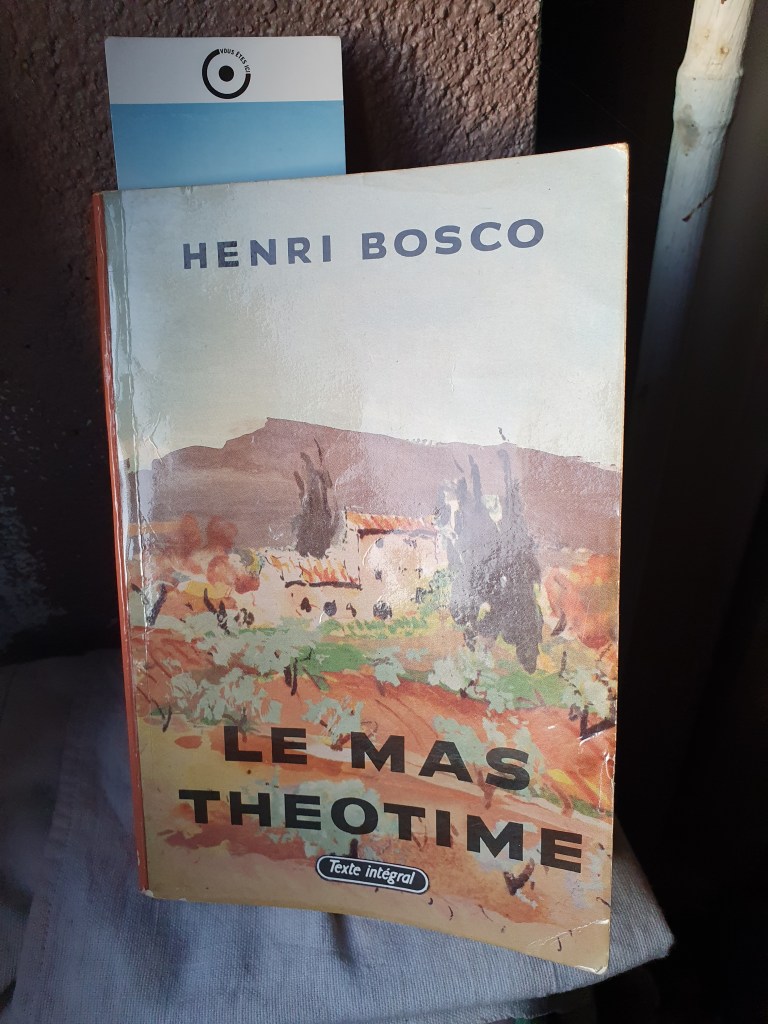En canot sur les chemins d’eau du Roi, quintessence de l’aventure
Un vrai roman d’aventure ! Comme on n’en trouve plus beaucoup (sauf chez Sylvain Tesson) et dans la veine d’Ella Maillart, d’Alexandra David-Néel, de Nicolas Bouvier… Hérissé de peaux-rouges, de fiers canotiers, de chasseurs de trésors et de marchands de fourrures, de Jésuites en robe noire, de farouches marins, miliciens, chevaliers, officiers du roi, explorateurs… Tous ces premiers Français du Québec, arrivés cent ans avant les Anglais, dont nous suivons les traces, au péril de leur vie, à travers le dédale des chemins d’eau dits du roi (Louis XIV), dans les anciens territoires du Québec et de l’Ontario, puis sur les Grands Lacs et au long du Mississippi jusqu’à la Louisiane. Fiers et jouant leur va-tout, malouins ou natifs du Perche, du Maine ou de Normandie, hommes (surtout) et femmes dont le caractère trempé a baigné ces rives de leur audace, de leur incommensurable détermination et esprit d’aventure. On navigue remontant les rapides, traversant les lacs imprévisibles comme des mers, emporté par le flot impétueux des larges fleuves, à la rencontre de cet inimitable esprit pionnier qui caractérisait leur race, escaladant les marches du temps en un pont dressé entre les siècles par l’art et la manière d’un incomparable conteur.
Cinquante-cinq ans après son aventure de jeunesse, Jean Raspail raconte, sur la base de ses carnets de bord retrouvés dans une vieille malle. Accompagné de trois autres lascars, ils ont relevé ce défi fou de remonter les cours de cette multitude de rivières et de lacs, depuis le fleuve Saint-Laurent à Trois-Rivières (entre Québec et Montréal) jusqu’à Ottawa, puis vers l’ouest pour rejoindre le lac Huron, le lac Michigan, et s’engouffrer plein sud dans le Mississippi pour relier le Golfe du Mexique, à plusieurs milliers de kilomètres de là… Cela donne « En canot sur les chemins d’eau du Roi – Une aventure en Amérique », récit au grand cœur et aux bras solides, mené au rythme des coups d’avirons, des portages de canots (portage : remonter des rapides à pied, en portant le canot sur les épaules, suivant un sentier riverain et pentu à travers la végétation dense), des campements hâtifs ou incertains, des repas frugaux, du manque de sommeil… à grand coup d’efforts et de témérité, dans le sillage de leurs illustres prédécesseurs, qui en leur nom propre ou au nom du roi avaient tracé la voie :
Jacques Cartier qui le premier, avait planté en 1534 (François 1er) l’écusson à fleur de lys sur le rivage du Saint-Laurent…
Samuel de Champlain, « Père de la Nouvelle-France », qui fonda en 1608 (Louis XIII) un comptoir fortifié à la pointe de Québec…
Jean Nicolet, explorateur et fourrurier qui vécut parmi les Algonquins et s’aventura dans les Grands Lacs en 1634…
Pierre-Esprit Radisson, commerçant de fourrures, qui explora le lac Supérieur et, ayant vainement cherché un appui en France, participa en 1670 à la fondation de la Compagnie de la baie d’Hudson pour le compte des Anglais…
le père Marquette et Louis Joliet, dont la mission en 1673 (Louis XIV), découvrit le Mississippi mais s’arrêta avant son embouchure, soucieux de tomber sur les Espagnols qui tenaient alors la Floride…
et Robert Cavelier de la Salle, qui acheva de relier en 1683 (Louis XIV) le Golfe du Mexique…
et une pléthore d’officiers du royaume qui repoussèrent, un siècle durant, les frontières françaises jusqu’aux contreforts des Rocheuses.
Le respect, l’admiration s’imposent devant la portée de leurs actes héroïques, jetés à la face d’un monde aux contours encore flous, donnant sens à leur existence, parfois courte, dont la trace tenace et l’écho se dressent entre l’Histoire et nous.
« Avec vos canots, vous le verrez, vous l’éprouverez, vous ne quitterez pas la France du roi. Aussi loin qu’on se le rappelle, ce sont toujours les hommes de France qui sont arrivés les premiers; ils sont les seigneurs de ces eaux » (Abbé Tessier, prêtre québecois, directeur des mouvements catholiques de jeunesse et inspirateur du projet de Jean Raspail et ses amis)
Jeunes, un peu têtes brûlées, scouts, royalistes, catholiques du bout des lèvres : grâce aux appuis du mouvement scout (scouts en anglais, les éclaireurs de la bataille de Mafeking, en Afrique du Sud, qui valurent aux Anglais la victoire sur leurs opposants Boers) – grâce à des introductions et soutiens de l’ambassade de France, à la presse canadienne, sympathique malgré elle, même en pays anglophone, puis à celle des États-Unis, et à la camaraderie des ultimes représentants des grandes tribus indiennes, médusés par leur grain de folie et leur ténacité (ils battront même des équipages d’Indiens à une course en canot), Jean et ses camarades, n’ayant jamais peur du ridicule, franchiront l’infranchissable, feront toutes les erreurs mais s’en sortiront bien.
Au départ piètres navigateurs mais rameurs fougueux et motivés, armés de cartes et de boussoles, et de solides bras dont les muscles se décupleront au fil des jours, ils auront tôt fait d’apprendre les leçons, ayant la sagesse de s’en remettre aussi souvent que nécessaire aux écrits de leurs prédécesseurs, aux cartes et aux recommandations, sachant quand il le faut murmurer des prières à Sainte-Anne, patronne des canotiers, ou indifféremment à l’Oiseau-Roc, totem incontournable au pied de rapides redoutables, à l’entrée en territoire sacré des Indiens. Les noms des lieux défilent, villages, forts, rapides, rivières, tous plus poétiques ou prosaïques les uns que les autres : l’Outaouais, les Chaudières, le Grand Calumet, Petites-Allumettes, rivière Creuse, le Rocher-Capitaine, rapide des Chats, Fort Coulonge, la rivière du Renard, Menominee-Marinette, Prairie-de-Chien, Portes de la mort, Pointe aux barques, Forts de Chartres, de Vincennes, Fort Saint Louis … inspirés des langues indiennes ou des surnoms donnés par les Français du Canada (il n’existe pas de Canadiens français ! leur criera, ulcéré, le maire de Montréal. Il n’y que des Canadiens, point à la ligne, et c’est nous ! Les autres, ce sont les Anglais…)
La carte datait de 1906, révisée en 1926 et 1938, avec hachures, courbes de niveau et toutes sortes de signes pictographiques, imprimée en noir de Chine sur un épais papier parcheminé. Elle ne se pliait pas, elle se roulait. Graphiquement, elle était superbe, typographiquement, poétique, avec un air de petite dernière dans la famille des cartes anciennes dont s’était servi Bougainville, par exemple, officier du roi en Nouvelle-France pendant la guerre de Sept Ans et familier de ces régions. Tous les rapides de la French River y figuraient, parfois en anglais, surtout en français. Au service géographique de l’armée canadienne, les chemins d’eau du Roi de France n’avaient pas démérité.Le Petit et le Grand Récollet, deux rapides annoncés comme « très dangereux » selon la signalisation indiquée en légende, à savoir trois traits transversaux barrant le cours de la rivière : vingt morts d’un coup en 1690, des franciscains gris, dits Robes grises, autrement appelés Récollets. Le rapide des Normands, des engagés des premiers temps, un seul trait mais vint-quatre morts à la remontée, trois canots surpris et leurs équipages massacrés par des Iroquois en embuscade. Le Petit et le Grand Parisien – Parisian Rapids – deux traits le premier, trois le second et dix-huit novices inexpérimentés, noyés et roulés par le courant. La rivière, en ses plus hautes eaux, en avait balayé toutes les croix. Les Grandes et les Petites Faucilles; trois traits, particulièrement meurtrières, d’où leur nom : le flot, enjambant les rochers submergés, prend la forme d’une succession de faucilles en mouvement, les petites d’abord, puis les grandes, corps de bataille en seconde ligne, qui guettent les voyageurs échappés du couperet liquide de l’avant-garde…
On a embarqué, décidés.
Ils apprennent à déjouer les pièges, à évaluer risques et courants, s’enduisent de graisse contre les insectes, maringouins, brûlots et mouches piquantes qui mènent un train d’enfer. Tout un univers.
En compagnie de Jean et de ses trois camarades, nous traversons, assez laconiquement, au rythme des miles conquis à la sueur de leur front et aux cloques de leurs main, des journées au ciel impeccable et des paysages splendides du Canada; nous remontons lacs et rivières, à la recherche d’un contre-courant, nous jaugeons les rapides, nous essuyons les averses diluviennes, nous pataugeons pieds dans l’eau en tirant les canots, nous bivouaquons sur une petite île, trempés jusqu’à la moëlle, à l’abri du canot retourné, à la lueur d’un faible mais rassurant feu de bois. Nous piochons dans nos dernières réserves (22è riz au lard). Nous dressons des ponts avec le passé, avec les fortins bâtis à la hâte, dérisoires forteresses de rondins qui ne constituent qu’un maigre rempart contre les hordes d’Iroquois ou d’Algonquins téméraires ou furieux, toujours impitoyables, parfois alliés aux Anglais. Nous relisons ces siècles d’histoire, humbles et muets devant leur courage nous saluons ces héroïnes, ces héros oubliés, qui sauvèrent leur famille, qui défendirent jusqu’à leur dernière goutte de sang une place, une maison, un campement. Nous rencontrons les ours et les oies sauvages, la grande nature silencieuse et sublime, solitaire. Nous participons aussi à des fêtes qui semblent décalées, accueil en fanfare avec les autorités et la presse, cocktails sur le gazon rasé de frais d’une ambassade, soirées irréalistes dans les bunkers des ingénieurs sur un site de construction – infimes concessions aux joies du voyage libre et sans maître, pour garantir à l’opération un minimum de soutien, de battage, et les fonds nécessaires à la survie de nos quatre coéquipiers.
Nous sommes en 1949, et déjà se dessinent les avant-postes des nouveaux colons : promoteurs touristiques, bâtisseurs de barrage, ingénieurs hydro-électriques, technocrates dessinant les contours de réserves indiennes où les derniers Hurons se glissent dans le rôle de leurs ancêtres, le temps d’une attraction touristique, où les derniers Algonquins noient leur cafard dans la bière bon marché, le whisky et le rhum. Et surtout, le plus pernicieux de tous les colons : le business du tourisme de masse. Déjà, les abords de certains lacs et de certaines rivières se sont émaillés de petits chalets, bateaux à moteur, jolies vacancières en courte jupe faisant du ski nautique. Déjà, sonne le glas d’une authenticité et d’une pureté qu’on ne retrouvera plus. Déjà, en certains lieux, les autocars de tourisme vomissent leurs masses anonymes et molles de voyageurs, déjà, le rafting organisé remplace l’aventure personnelle.
Des radeaux de la taille d’un petit autocar, bardés d’énormes boudins gonflables et pourvus de gouvernails de péniche, embarquent pour le grand frisson tarifé une vingtaine de passagers alignés sur des banquettes à un mètre cinquante au-dessus de l’eau, sanglés dans leurs gilets de sauvetage orange et la ceinture de sécurité bouclée. Une noria de bus et de trucks à plate-forme remonte tout cela au point de départ. La rivière, au cœur de l’été, est tout aussi saturée qu’une aéroport en période de vacances. Comme le Boeing 747 ou tout autre gros porteur desservant des lieux naguère préservés, le raft est un pollueur de rêve, un briseur d’aventure vraie, un casseur d’authenticité, un multiplicateur de parasites. Il introduit la foule là où elle n’aurait jamais dû pénétrer. Le monstre festif n’est plus à l’échelle de la rivière. Il l’écrase de toute sa masse surdimensionnée. Il l’a vaincue. A vaincre sans péril, etc. Autrefois les morts la sanctifiaient. La rivière ne prélève plus son tribut. Elle a perdu son caractère sacré…
Me reviennent, à la lecture de ce passage, les images du Gange au-dessus de Rishikesh, lieu sacré par excellence (comme toutes les villes sur les rives du Gange), envahi lui aussi de radeaux oranges et de touristes criards venant troubler ces lieux de silence et de sainteté, ces grottes d’ermites aux vastes empires d’intériorité dont l’aura délicate emplit encore toute la vallée… sacrilèges multiples de notre époque qui s’est éloignée de ses origines, et de nos contemporains qui ne respectent plus rien. Que faire, sinon refuser de participer à la grande kermesse, s’engager à préserver la nature et l’authenticité, rappeler à l’homme, en toute occasion, qu’il n’est de pouvoir sur terre que temporel, et que le vrai royaume est ailleurs…
Un grand silence nous entourait. M’est revenue une fois de plus cette impression que nous nous mouvions entre deux mondes dans un no man’s land de cent années, ceux des anciens temps nous ayant quittés, ceux des nouveaux temps n’étant pas encore arrivés. Ces derniers se sont rattrapés depuis. J’ai revu Fort William en 1996. Là où cabanaient les sauvages et où nous avions nous-mêmes campé, solitaires, des dizaines d’autocars de tourisme étaient alignés. Il y avait un centre d’accueil, des guides en costumed’époquee, de vrais faux Indiens, des ballots de fourrure dans les entrepôts, de la marchandise de troc, des barils, des canots d’écorce, tout cela joliment reconstitué, avec dioramas, vitrines et sono à l’unisson. Un forgeron forgeait. Un trappeur façonnait des pièges. Des figurants jouaient des saynètes. Fort William était devenu « centre culturel, lieu de mémoire, musée de vie de l’Outaouais ». Des nuées de gamins d’origines variées s’y mêlaient à des bataillons de seniors québecois ou ontariens, à des Japonais, des Etats-Unisiens, des croisiéristes transportés en tapis volant depuis leurs paquebots sur le Saint-Laurent. Qu’est-ce qu’ils faisaient là, sur mon chemin ? Où était ma propre mémoire ? Comment la retrouver dans ce fatras humain ? J’étais pourtant venu à cet endroit. J’y avais rêvé. On avait court-circuité mon rêve. Tous ces gens effrayaient les ombres dont j’avais autrefois senti la présence, en un temps qui n’était ni le leur ni le mien…
Voilà ce qui m’a touchée, dans ce livre : cette angoisse que j’ai de même tant de fois ressentie devant l’inéluctable cours des choses, vers une lente dégradation du monde, de l’environnement, par les parasites humains, devant l’affreuse et perpétuelle tentation de l’homme, à corrompre, détruire, pourrir, désacraliser. Un cri d’amour désespéré, au monde des origines dont nous nous éloignons toujours plus, tels des cosmonautes sevrés de leur capsule, errant pour l’éternité en orbite autour du souvenir d’un monde inaccessible. Voilà ce que je ressens profondément et qui me hante, jour après jour, nuit après nuit, dans ma propre vie.
Ainsi ayant, grâce à ce récit de l’expédition Marquette, suivi quatre jeunes hurluberlus en canot, navigué entre le passé et le présent, ayant constaté l’inexorable cours du temps, s’étant avec eux exclamé ou lamenté, selon le cas, devant les marques admirables ou pitoyables laissées dans leurs sillages (d’eau claire ou de vase) par les explorateurs des siècles passés, ayant rêvé, avec Nicolet se lançant à l’assaut des rapides habillé en mandarin, de découvrir derrière un passage vers la Chine (les rapides conserveront le nom de Lachine !), nous débarquons au terme de cette aventure, essoufflés, époustouflés, un peu nostalgiques et saisis de l’esprit d’aventure. Avec du moins quelque chose de grandi en nous – car ce récit est également une belle et passionnante manière d’appréhender l’histoire et la géographie de l’Amérique du Nord coloniale : le Québec, les Grands Lacs, le bassin du Mississippi (qui, du temps des Français apprend-on, s’écrivait avec un seul p) et les contours des anciens territoires français … On ne peut que regretter, avec l’auteur, que Louis XV ait vendu en 1763 le Canada français à la Couronne britannique, et que Napoléon Bonaparte ait cédé, pour quelques millions de dollars, la Grande Louisiane aux États-Unis en 1803. Et espérer que d’autres mondes, intérieurs peut-être ? soient encore à découvrir – puisque la vaste terre ne semble plus receler de territoires inconnus…

Albin Michel, 2005 (ici Livre de Poche)
texte (à part les extraits) et photos, (c) DM août 2025
photo de couverture : canyon de Ruinaulta, vallée du Rhin, Suisse